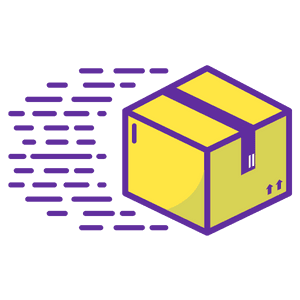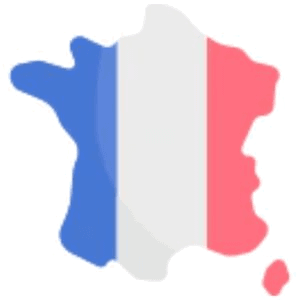Combien y a-t-il de planètes des singes ? Un décryptage scientifique
L’univers cinématographique regorge de mondes inconnus, mais peu sont aussi fascinants que ceux explorés dans la saga mythique de la Planète des Singes. Depuis la sortie du film original en 1968, cette franchise n’a cessé d’évoluer au fil des décennies, soulevant une question qui intrigue aussi bien les fans que les curieux : combien y a-t-il de planètes des singes au final ?
Une seule planète… ou plusieurs versions ?
À première vue, on pourrait croire qu’il n’existe qu’une seule véritable planète des singes : un monde parallèle ou futuriste dominé par des primates intelligents et organisés. Pourtant, avec les différentes lignes temporelles, reboots et récits alternatifs proposés par les œuvres cinématographiques et littéraires, on se rend rapidement compte qu’il ne s’agit pas d’une seule et unique planète, mais de plusieurs interprétations de celle-ci.
Dans la version originale inspirée du roman de Pierre Boulle paru en 1963, la planète s’appelle Soror (sœur, en latin). Les scientifiques de la Terre y découvrent une société dominée par des singes civilisés. Dans les films produits par la suite, cette planète change d’identité, de contexte temporel et même de nature géographique, au point qu’il devient difficile d’en dénombrer avec exactitude les versions.
La saga originale (1968-1973) : une boucle temporelle complexe
La première série de films de la 20th Century Fox comprend cinq longs-métrages iconiques. Ici, la planète des singes n’est autre que la Terre… dans un lointain futur, ravagée par la guerre nucléaire et dominée par des singes ayant évolué. Ce retournement scénaristique bouleverse la perception que l’on pourrait avoir d’une “planète extérieure” et suggère en fait que l’humanité court vers sa propre extinction.
Chaque film épouse une évolution supplémentaire de cette Terre inversée, jusqu’à “La bataille de la planète des singes”, où l’on tente de bâtir un fragile équilibre entre hommes et singes. On assiste ici non pas à la découverte d’une nouvelle planète, mais à des transformations progressives d’un même monde sur différentes périodes.
Reboot de 2001 et nouvelle trilogie (2011-2017) : des versions divergentes
En 2001, Tim Burton propose sa propre version avec un scénario davantage tourné vers la science-fiction pure, où l’astronaute Leo Davidson échoue sur une planète des singes différente. Ici, les humains et les singes s’affrontent dans un cadre totalement distinct de la Terre originelle. C’est une autre planète — une entité autonome — sans lien évident avec notre propre monde, bien qu’elle réserve un dénouement ambigu.
Puis vint la trilogie acclamée « Rise », « Dawn » et « War » entre 2011 et 2017. Elle retrace l’origine de l’intelligence simienne sur Terre, générée par une modification génétique involontaire. L’histoire reste centrée sur notre planète, mais dépeint sa lente transformation en une **planète des singes**. Ces films ne présentent pas un nouveau monde spatial, mais montrent l’évolution dramatique de notre propre société sous l’influence de sciences déstabilisées.
Des planètes multiples dans l’imaginaire collectif
Si l’on parle de planètes au sens strictement astronomique, on ne peut guère en compter qu’une ou deux — selon qu’on considère les versions basées sur la Terre ou des mondes totalement fictifs. En revanche, du point de vue narratif, on peut estimer qu’il existe au moins quatre grandes déclinaisons distinctes de la planète des singes dans l’univers cinématographique et littéraire :
- Soror dans le roman original.
- La Terre du futur dans la saga classique (1968-1973).
- Une planète étrangère dans la version de Tim Burton (2001).
- La Terre évolutive dans la trilogie moderne (2011-2017).
À cela s’ajoutent les comics, les jeux vidéo et les séries télévisées qui proposent parfois d’autres mondes simiesques. Chacun constitue une variation autour de la même idée : une civilisation de singes ayant surpassé l’humanité.
Conclusion : combien y a-t-il de planètes des singes ?
Scientifiquement parlant, et en tenant compte de la nature fictionnelle de ces récits, on peut dire qu’il y a au moins quatre planètes des singes majeures, chacune répondant à des contextes narratifs et scientifiques différents. Leur existence ne remet pas en cause nos connaissances astronomiques actuelles, mais illustre plutôt la capacité de l’homme à imaginer des ailleurs où il n’est plus maître du vivant.
Ces mondes peuplés de singes intelligents nous renvoient à nos propres angoisses : évolution, intelligence artificielle, guerre nucléaire, éthique scientifique… La planète des singes n’est donc pas qu’une fiction spatiale. C’est aussi une réflexion sur notre avenir.